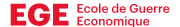L’interaction entre la guerre économique et la guerre informationnelle entre la Chine et Taïwan
En avril 2018, la Chine a astreint 36 compagnies aériennes internationales à modifier la manière dont elles désignent leurs vols à destination ou en provenance de Taïwan, considérant cette dernière depuis 1949 comme une région dissidente. Ces compagnies ont été contraintes de retirer toute référence à Taïwan comme un pays indépendant, et de présenter explicitement le territoire comme faisant partie de la Chine (ce sur les billets d’avions, les sites internet et tout support présentant la mention de la destination ou de la provenance). Cette exigence, bien que semblant insignifiante, s'inscrit dans une stratégie de guerre politique, économique et informationnelle visant à affirmer la souveraineté de Pékin sur Taïwan au sein de la scène internationale.
L’interaction entre la guerre économique et la confrontation informationnelle entre la Chine et Taïwan se définit par des actions ciblées de Pékin, visant à affaiblir économiquement Taiwan par diverses pratiques (sanctions économiques, espionnage, dumping) et à manipuler l’information en usant de son influence (désinformation, cyberattaque). La Chine, adepte de la stratégie du jeu de Go, ne cherche pas dans un premier temps à affronter militairement son rival taïwanais mais à l’étouffer économiquement et politiquement de manière progressive. Taïwan est un pays utilisant et bénéficiant de la mondialisation pour son économie, le conduisant à avoir un certain nombre de relations avec de grandes puissances et d’importantes zones géographiques (Europe, USA, etc.). Si cette capacité à pouvoir commercer avec l’extérieur est une force pour le développement économique du pays, il se révèle être également une menace par les risques d’ingérences auxquels une ouverture libérale d’une économie conduit. Taïwan est donc vulnérable sur le plan économique, par son marché libéral ouvert à l’économie de marché, et sur le plan informationnel, à travers les médias d’informations, et surtout par la libre circulation des données via internet et les réseaux sociaux. Il convient donc de s’intéresser à la manière donc la Chine livre une guerre économique et informationnelle à l’encontre de Taïwan à travers différents leviers de coercition, de manipulation ainsi que de déstabilisation.
Une guerre diplomatique de la Chine à l’échelle internationale
La Chine utilise de nombreux mécanismes pour influencer et livrer une guerre informationnelle face à Taïwan. Tout d’abord, il est important de voir que la Chine considère Taïwan comme un territoire lui appartenant, étant en dissidence depuis la guerre civile chinoise (1927-1949). Pour la Chine, la réunification est inévitable et met tout en oeuvre pour qu’elle intervienne. Ajouté à ces raisons historiques, la position de Taïwan, au large d’îles japonaise et situé dans le détroit de Taïwan (sur lequel la Chine considère sa compétence), est stratégique. Pour faire progressivement reconnaitre Taïwan comme une province appartenant à la Chine, cette dernière applique le principe de la "One China Policy", une théorie diplomatique rejetant toute reconnaissance de Taïwan en tant qu’Etat indépendant et considérant la Chine continentale (sous gouvernement de Pékin) comme la seule Chine légitime. Ce principe a tendance à se renforcer avec le temps comme dans l’exemple précédemment nommé sur les compagnies aériennes forcées de modifier leur appellation de Taïwan. A travers cette position diplomatique, l’objectif est de réduire les relations internationales de Taïwan sans pour autant fermer toute relation économique (qui fera l’objet d’un point détaillé). L’idée est également de faire disparaitre progressivement à l’échelle internationale l’existence de Taïwan, ce qui pourrait rendre à terme plus simple une éventuelle réunification. La One China Policy est systématiquement appliquée avec la Belt & Road Initiative (BRI) et les projets de développement des nouvelles routes de la soie, notamment lorsque la Chine noue de nouvelles relations commerciales, étendant son influence économique tout en affaiblissant la position géopolitique de Taïwan, ce dernier perdant progressivement des alliés diplomatiques. Ces idées sont notamment inscrites avec les relations avec les pays africains, d’Amérique du Sud et d’Océanie avec par exemple le cas de Nauru ayant reconnu Taïwan comme faisant partie de la Chine afin de pouvoir établir des relations économiques avec Pékin. Cette même rhétorique est également utilisée au sein des organismes internationaux, la Chine souhaitant éviter toute obtention de rôle au sein d’organismes comme les Nations Unies, l’Organisation Mondiale de la Santé (notamment durant le Covid-19), Interpol, ou encore auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale). Taïwan peine donc à obtenir certains statuts, parfois même en tant que simple observateur, et la Chine veille à oeuvrer pour limiter son influence et ses pouvoirs. Taïwan peut néanmoins bénéficier de certains "alliés", bien que sans reconnaissance directe. Les États-Unis soutiennent Taïwan sur le plan diplomatique, au même titre que certains pays d’Europe, ou encore le Japon et la Corée du Sud. Les pays entretenant des relations diplomatiques avec Taïwan cherchent en premier lieu à limiter l’influence de la Chine, notamment sur le plan économique, mais restent limités dans leurs actions en raison des risques de rétorsions économiques que la Chine peut prendre en cas de non-respect de certaines de ses conditions.
Une influence de la Chine à l’échelle locale
Plus localement, la Chine exerce diverses activités d’influence à l’égard d’une part de sa propre population, mais également à l’égard des Taïwanais. A l’échelle nationale, la Chine véhicule au sein de ses médias et de tout support éducatif un narratif représentant Taïwan comme une province dissidente ne pouvant donner lieu à terme qu’à une réunification avec la Chine continentale, de gré ou de force. Cette prise de position renforce l’idée d’une unité nationale à l’égard d’un territoire égaré. Au niveau taïwanais, la Chine n’hésite pas à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir des contenus prochinois, anti-taïwan et de désinformation à l’égard des dirigeants taïwanais. L’idée est d’utiliser des plateformes comme YouTube, Facebook, mais surtout TikTok (un réseau social chinois, soupçonné d’entretenir des liens forts avec le gouvernement chinois), très populaire dans la région, afin d’orienter l’opinion publique. Tiktok a ainsi été accusé de promouvoir dans la région via son algorithme des vidéos de désinformation politique (à l’encontre du gouvernement taïwanais au pouvoir -le Parti Démocrate Progressiste-, hostile à la Chine continentale et à la réunification) à l’approche des élections, de contenus d’influenceurs (faux taïwanais expliquant un quotidien idyllique en Chine, personnalités pro-pékin), ou encore de contenus angoissants (représentant un avenir morose, dystopique à Taïwan, ventant les bénéfices d’une réunification). La désinformation est d’ailleurs utilisée sur divers aspects, allant de la promotion de contenus indiquant des mensonges du gouvernement à l’égard des morts du Covid-19, à des affaires de corruption. L’objectif est multiple, notamment en créant progressivement un climat social instable, de semer la discorde sociale en influençant les élections taïwanaises et d’alimenter un sentiment pro-réunification au sein de la population. Enfin, certains journaux locaux, comme le China Times, sont accusés de diffuser des opinions prochinoises biaisées, notamment depuis leur acquisition par des propriétaires ayant des intérêts économiques significatifs en Chine.
Une déstabilisation progressive de l’économie taïwanaise
Au-delà de l’aspect de l’influence cognitive et diplomatique, la Chine utilise des leviers d’intelligence économique pour déstabiliser progressivement l’économie taïwanaise. Taïwan est un pays possédant des secteurs de productions stratégiques, notamment centrés sur des hautes technologies. Le pays possède les plus importantes usines de puces électroniques et de fonderies de semi-conducteurs avec environ 75% de la production mondiale (via notamment l’entreprise TSMC). Ils sont également parmi les plus avancés dans la recherche de ces technologies avec des progrès notables dans la miniaturisation des transistors sur une échelle de quelques nanomètres (3 nanomètres pour la production à grande échelle et en développement du 2 nanomètres). Ces avancées sont cruciales pour le développement des technologies du quotidien (ordinateurs, voitures, etc.) par des puces toujours plus performantes, et représentent donc un enjeu international majeur pour l’accès à des technologies de pointe (médicales, ordinateur quantique, spatial, transports autonomes, etc.). Ce sont ces enjeux qui conditionnent principalement la rivalité entre la Chine et les États-Unis, ces derniers apportant donc leur soutien à Taïwan. La Chine est donc elle-même d’une certaine manière dépendante à Taïwan sur ce secteur si elle souhaite développer ses technologies et c’est principalement cette dépendance qu’elle souhaite réduire. Au-delà des enjeux sur les semi-conducteurs, de fortes concurrences sont également présentes sur certaines technologies renouvelables et de télécommunication comme la 5G.
La Chine utilise donc divers instruments comme la création de programmes incitatifs de récupération de talents taïwanais et d’individus qualifiés afin de développer sa filière de semi-conducteurs, mais aussi en ayant recours au vol de technologies, par le biais de l’espionnage mais aussi du piratage de grandes entreprises du secteur afin de récolter des données confidentielles. D’autres outils, comme des subventions pour inciter à la délocalisation de la production en Chine continentale sont utilisés à l’égard des entreprises, offrant des perspectives de développement à ces dernières. En outre, diverses autres formes d’ingérences économiques sont également employées comme le blocage à l’importation de certains produits taïwanais, des restrictions commerciales, du dumping économique (vente à perte de certains produits sur le marché dans le but d’affaiblir un concurrent), par des sanctions financières, ou encore par le détournement des partenaires commerciaux de Taïwan.
La Chine utilise également des contrats sur les marchés à terme pour déstabiliser l’économie taïwanaise, notamment en incitant à des pratiques de vente à découvert ciblées. Cette stratégie consiste à parier sur la baisse de la valeur d’actifs stratégiques, tels que les actions d’entreprises taïwanaises dans des secteurs clés, comme celui des semi-conducteurs. En créant artificiellement une pression à la baisse sur les cours boursiers, souvent alimentée par des campagnes de désinformation ou des rumeurs orchestrées, ces manœuvres visent à affaiblir la confiance des investisseurs dans l’économie taïwanaise. Cela entraîne une chute des valeurs boursières et un ralentissement de l’accès au financement pour les entreprises concernées. Ce type de levier économique, combiné à d'autres actions, s’inscrit dans une volonté d’affaiblir progressivement la position économique de Taïwan sur la scène internationale, tout en rendant ses industries stratégiques plus vulnérables aux influences extérieures, notamment celles de la Chine.
Ajouté à ce type de manœuvre, les pressions militaires chinoises exercées près des côtes taïwanaises réduisent la confiance des investisseurs à Taïwan sur le long terme. En effet, la menace d’une invasion ou de manœuvres militaires près de Taïwan fait partie de la stratégie de la Chine pour perturber les marchés et créer de l’incertitude économique. L’ensemble de ces pressions reste permanent et on assiste régulièrement à des démonstrations de force militaire, couplées à des augmentations des dépenses militaires dans les deux camps.
Incertitude mondiale
Ces tensions présentes entre la Chine et Taïwan on un impact significatif sur le commerce international. En effet, la guerre économique entre la Chine et Taïwan affecte les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment dans les secteurs de la technologie, des semi-conducteurs et de l’électronique. Ces incertitudes créent de nouvelles dynamiques conduisant les puissances à progressivement revoir leurs dépendances et leurs alliances en prévision d’une potentiel conflit sur la région pouvant conduire à d’importantes pénuries qui deviendraient dommageables pour de nombreuses technologies, impactant de nombreuses productions et faisant craindre de graves répercussions économiques. Ces tensions influencent donc les marchés boursiers, les investissements directs étrangers (IDE), et crée une instabilité économique majeure dans la région.
Thibaud Rifflart (SIE28 de l’EGE)
Sources
Ekman, A. (2021). Rouge vif : L’idéal communiste chinois.
Gavroche. (2024, 5 juillet). SINGAPOUR archipel, lien économique entre la Chine et Taïwan. Gavroche Thaïlande. https://www.gavroche-thailande.com/singapour-economie-larchipel-lien-economique-entre-la-chine-et-taiwan/
Hale, E. (2021, 26 octobre). Taiwan taps on United Nations’ door, 50 years after departure. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2021/10/25/chinas-un-seat-50-years-on
Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan) 中華民國外交部. (s. d.). https://web.archive.org/web/20130513220940/http://www.mofa.gov.tw/EnOfficial
Pluyette, C. (2024, 17 novembre). Pourquoi l’administration Trump 2.0 pourrait devenir la plus anti-Chine de l’Histoire. L’Express. https://www.lexpress.fr/monde/amerique/pourquoi-ladministration-trump-20-pourrait-devenir-la-plus-anti-chine-de-lhistoire-W5GW7PAKYRHDZLEAZRSHAMI62U/
Pourquoi le micro-État de Nauru abandonne Taïwan au profit de Pékin. (2024, 17 janvier). France 24. https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20240117-asie-pacifique-pourquoi-nauru-abandonne-ta%C3%AFwan-au-profit-de-p%C3%A9kin
Taïwan se dit prêt à affronter une invasion communiste, un rapport évoque une guerre économique | Epoch Times. (2024, 9 octobre). EpochTimesParis. https://www.epochtimes.fr/taiwan-se-dit-pret-a-affronter-une-invasion-communiste-un-rapport-evoque-une-guerre-economique-2749476.html
Targeting Taïwan. (2024). Dans FDD. https://www.fdd.org/analysis/2024/10/04/targeting-taiwan/
U.S. Relations With Taiwan - United States Department of State. (2024, 13 juin). United States Department Of State. https://www.state.gov/u-s-relations-with-taiwan/
Wu, T., & Moritsugu, K. (2024, 16 janvier). Nauru switches diplomatic recognition to China from Taiwan | AP News. AP News. https://apnews.com/article/taiwan-nauru-china-diplomacy-f8c6b74c03b61b51415c00b9e2bc32e1