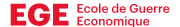Depuis l'ère de la Guerre froide, les compétitions sportives internationales majeures se sont métamorphosées en arènes symboliques où s'affrontent les puissances rivales. Les Jeux olympiques, en particulier, ont servi de théâtre à une confrontation acharnée entre les États-Unis et l'Union soviétique, chacun cherchant à démontrer sa suprématie non seulement athlétique, mais aussi idéologique et technologique. Chaque médaille conquise et chaque record établi revêtait une dimension géostratégique, projetant une image de puissance et d'excellence à l'échelle mondiale.
Les Olympiades de 1980 à Moscou et de 1984 à Los Angeles ont cristallisé cette instrumentalisation du sport à des fins politiques. En réaction à l'intervention soviétique en Afghanistan, l'administration Carter orchestra un boycott des Jeux de Moscou, privant l'URSS d'une confrontation directe avec l'élite sportive occidentale. Quatre ans plus tard, l'Union soviétique riposta en organisant son propre boycott des Jeux de Los Angeles, entraînant dans son sillage plusieurs nations du bloc de l'Est. Ces épisodes, transcendant le simple cadre sportif, illustraient l'intensité de la rivalité bipolaire.
Quatre décennies plus tard, la Fédération de Russie se retrouve à nouveau au cœur d'un conflit géopolitique où le sport sert de vecteur d'influence, mais dans un contexte radicalement différent. Moscou, loin de boycotter volontairement les événements internationaux, se voit exclu de nombreuses compétitions. Dans un climat exacerbé par le conflit en Ukraine, les instances sportives occidentales, sous pression politique, ont écarté les athlètes russes de multiples compétitions, y compris des Jeux olympiques de 2024 sous bannière nationale.
Une nouvelle forme d’instrumentalisation du sport
Face à cette mise au ban, la Russie déploie une stratégie alternative avec l'instrumentalisation du sport comme levier de soft power à travers l’organisation des Jeux des BRICS. L'initiative russe des Jeux alternatifs s'inscrit dans une stratégie géopolitique complexe et multidimensionnelle, conjuguant soft power, diplomatie sportive et construction narrative nationale. Cette démarche, qui émerge dans un contexte d'isolement diplomatique et d'exclusion des compétitions internationales majeures, vise à repositionner la Russie sur l'échiquier mondial tout en consolidant sa cohésion interne.
Sur le plan international, les Jeux des BRICS servent d'instrument de contestation de l'hégémonie occidentale dans la gouvernance sportive mondiale et, par extension, de l'ordre libéral international. En créant un événement sportif alternatif, Moscou cherche à renforcer son leadership au sein des nations émergentes, à structurer le Sud global, et à promouvoir un modèle multipolaire de relations internationales. Cette initiative s'inscrit dans une logique plus large de défi à l'Occident, visant à redéfinir les équilibres mondiaux et à consolider des alliances stratégiques indépendantes des puissances traditionnelles.
Parallèlement, sur le plan intérieur, l'organisation des Jeux des BRICS participe à la construction d'un récit national sophistiqué. Ce narratif, articulé autour des thèmes de résilience, de grandeur historique et d'alternative à l'ordre occidental, vise à renforcer la cohésion sociale, à légitimer le pouvoir en place et à mobiliser le sentiment patriotique. En présentant la Russie comme une puissance incontournable capable de surmonter l'adversité internationale, ce discours sert à justifier la continuité du régime et à détourner l'attention des difficultés internes.
Cette stratégie multifacette illustre la complexité des enjeux géopolitiques contemporains, où le sport devient un vecteur de soft power et un instrument de reconfiguration des relations internationales. Elle souligne également l'interdépendance croissante entre politique intérieure et extérieure, la légitimité du pouvoir se construisant désormais autant sur la scène internationale que nationale. Les implications à long terme de cette initiative restent à évaluer, notamment sa capacité à véritablement concurrencer les grands événements sportifs traditionnels et à influencer durablement les alliances géopolitiques. Néanmoins, elle témoigne d'ores et déjà d'une évolution significative dans l'utilisation du sport comme outil de politique étrangère et de construction identitaire nationale dans un monde en mutation.
Dans le cadre de l'analyse de l'initiative russe des Jeux des BRICS, il convient d'adopter une approche tridimensionnelle pour appréhender la complexité et les implications multiscalaires de ce phénomène. Cette étude s'articulera autour de trois axes majeurs, permettant d'explorer les diverses facettes de cette stratégie sportivo-diplomatique de guerre de l’image et de l’information.
Dans un premier temps, nous examinerons les Jeux des BRICS en tant qu'instrument de soft power et de diplomatie sportive russe, en analysant leur genèse dans un contexte d'isolement international, leur rôle dans la contestation de l'hégémonie occidentale, et leur fonction dans la reconfiguration des alliances géopolitiques, notamment au sein du Sud global.
Ensuite, nous nous pencherons sur la dimension interne de cette initiative, en étudiant son rôle dans la construction d'un récit national de résilience et de grandeur. Nous analyserons comment cet événement participe à la légitimation du pouvoir en place et au renforcement de la cohésion sociale, tout en servant d'outil de gestion de l'opinion publique face aux défis intérieurs.
Enfin, nous procéderons à une analyse critique du discours officiel autour des Jeux des BRICS, en confrontant les chiffres et les déclarations émises par les autorités russes à des sources indépendantes. Nous examinerons également la réception de cet événement par la communauté internationale, en évaluant son influence réelle sur les relations diplomatiques et économiques de la Russie. Cette analyse permettra d'apprécier objectivement l’efficacité de cette stratégie de soft power et d’en mesurer les implications à long terme pour la position géopolitique de la Russie.
Cette approche analytique permettra de saisir la complexité des enjeux liés aux Jeux des BRICS, en mettant en lumière l'interdépendance croissante entre les stratégies de politique étrangère et les dynamiques internes dans le contexte géopolitique contemporain.
Un levier de soft power au service de l’influence russe
Dans un contexte géopolitique marqué par la marginalisation progressive de la Russie au sein des institutions sportives occidentales, les Jeux des BRICS apparaissent comme une plateforme stratégique permettant à Moscou de redéfinir son image et d’affirmer son influence sur la scène internationale. Présenté comme un événement de coopération et de fraternité entre nations émergentes, ce rendez-vous sportif s’inscrit en réalité dans une logique plus large de contournement des sanctions occidentales et de construction d’un espace d’influence alternatif.
Depuis le début du conflit en Ukraine en 2014, et plus encore après l’invasion de 2022, la Russie a fait l’objet de sanctions sans précédent dans le domaine sportif. L’exclusion des athlètes russes des Jeux olympiques et des compétitions internationales sous l’égide du Comité international olympique (CIO), ainsi que les nombreux boycotts de ses équipes et fédérations, ont considérablement réduit la visibilité du sport russe sur la scène mondiale.
L'agence de presse TASS, fondée en 1904 sous le nom de Telegrafnoye agentstvo Sovetskogo Soyuza, s'est imposée comme une source d'information officielle du Kremlin. Disposant d'un réseau international couvrant plus de 60 pays et diffusant des contenus en russe, anglais, espagnol, arabe et chinois. TASS constitue un vecteur privilégié pour la dissémination de la perspective du Kremlin à l'échelle mondiale.
Dans un article publié le 30 juillet 2024, TASS a relayé des critiques virulentes à l'encontre des Jeux olympiques de Paris 2024, les qualifiant d'échec moral et sportif. L'agence a notamment mis en exergue l'exclusion des athlètes russes, arguant que cette décision contrevenait aux principes fondamentaux du mouvement olympique. Une comparaison polémique a été établie entre cette exclusion et les pratiques observées lors des Jeux de 1936 sous le régime nazi. L'article souligne l'impact présumé de l'absence des athlètes russes sur la qualité et l'équité des compétitions, citant notamment le judo comme discipline où les podiums auraient été significativement différents avec la participation russe. TASS relève également ce qu'elle perçoit comme une incohérence dans le traitement des nations, pointant la participation d'Israël malgré ses actions militaires au Liban, et questionnant l'exclusion de la Biélorussie, que Moscou ne considère pas comme belligérante.
En réponse à cette situation, l'article évoque la possibilité de créer des jeux alternatifs, prétendument plus fidèles aux principes originels de l'Olympisme. Une proposition symbolique de modifier le logo olympique en retirant l'anneau représentant le continent russe est également mentionnée.
La rhétorique déployée dans cet article reflète les arguments récurrents de la diplomatie russe, notamment la référence au nazisme comme antagoniste historique de Moscou. Le ton et le contenu de l'article ne laissent guère de doute quant à son origine et ses objectifs de communication stratégique.
Il est important de préciser que l’agence TASS s’est vu retiré ses accréditations pour les JO2024 le 29 juillet soit la veille de l’article ci-dessus.
Dans le contexte géopolitique actuel, la Russie déploie une stratégie de communication sophistiquée pour contrer son exclusion des compétitions sportives internationales majeures. En mobilisant ses médias d'État et les canaux de communication des BRICS, Moscou élabore un contre-récit qui présente l'exclusion de ses athlètes comme une manifestation d'injustice orchestrée par les puissances occidentales. Cette narration alternative trouve un écho favorable auprès des nations du Sud global, renforçant ainsi la cohésion entre ces pays qui perçoivent dans cette situation une illustration des pressions exercées par l'Occident sur les États non alignés.
L’anticipation d’une nouvelle mise à l'écart des compétitions internationales
La Russie a élaboré une réponse stratégique avec la création et la promotion des Jeux des BRICS. Annoncée lors du Forum International Russie-Chine le 8 septembre 2023, la présentation de cet événement à Kazan en 2024 constitue une manœuvre diplomatique habile. Cette initiative offre à la Russie une plateforme médiatique significative, lui permettant de réaffirmer son rôle central au sein d'un réseau de puissances émergentes, tout en contestant l'hégémonie occidentale sur la gouvernance sportive internationale. Les Jeux des BRICS s'inscrivent ainsi dans une stratégie plus large de soft power, visant à reconfigurer les équilibres géopolitiques à travers le prisme du sport et à consolider l'influence russe au sein des nations émergentes.
La mise en exergue des cinq drapeaux nationaux des pays membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) dans l'iconographie et la communication officielle des Jeux témoigne d'une stratégie délibérée d'inclusion et de représentation équitable. Cette approche symbolique vise à renforcer la cohésion du groupe et à affirmer son identité collective sur la scène internationale.
De plus, cette mise en valeur des symboles nationaux contraste délibérément avec l'approche des Jeux Olympiques traditionnels, où les athlètes russes sont contraints de concourir sous bannière neutre. Ainsi, les Jeux des BRICS se positionnent comme un espace où l'identité nationale est célébrée plutôt qu’effacée, renforçant l'attrait de l'événement pour les pays participants et potentiellement pour d'autres nations émergentes aspirant à une reconnaissance internationale accrue.
Les Jeux des BRICS transcendent leur dimension purement sportive pour s'ériger en véritable opération de prestige géopolitique pour la Fédération de Russie. Cet événement constitue une démonstration tangible de la capacité de Moscou à orchestrer des manifestations internationales d'envergure, en dépit des sanctions occidentales et des tentatives d'isolement diplomatique. En capitalisant sur son expertise logistique et organisationnelle, forgée notamment lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et de la Coupe du monde de football en 2018, la Russie cherche à réaffirmer son statut de puissance incontournable sur la scène mondiale, contestant ainsi l'efficacité des mesures punitives occidentales.
La stratégie de communication déployée autour de l'événement s'articule autour d'une rhétorique d'ouverture et d'hospitalité, visant à projeter l'image d'une Russie accueillante et bienveillante. Cette narrative s'inscrit dans une démarche plus large de soft power, cherchant à contrebalancer les perceptions négatives véhiculées par les médias occidentaux. Cette cérémonie a mis en scène une parade des drapeaux incluant non seulement les pays membres des BRICS, mais aussi des nations occidentales. Les porteurs de drapeaux sont entrés en scène par ordre alphabétique, comprenant notamment la France, l'Italie, le Royaume Uni et l'Allemagne.
Cette inclusion délibérée de drapeaux occidentaux, y compris celui d’Israël et de la Palestine, témoigne de la volonté de la Russie de présenter l'événement comme une compétition véritablement internationale et inclusive, transcendant les clivages géopolitiques traditionnels. Le même support vidéo est utilisé sur TIKTOK avec différents messages en différentes langues. (Figure 4 et 5) Cette stratégie vise à renforcer la légitimité des Jeux des BRICS en tant qu'alternative crédible aux Jeux Olympiques, tout en soulignant l'ouverture apparente de la Russie envers les nations occidentales, malgré les tensions diplomatiques actuelles.
Cependant, l'analyse de la cérémonie d'ouverture révèle un décalage entre les ambitions affichées et la réalité de l'exécution. La tenue de cet événement inaugural dans un cadre scénique relativement modeste, dépourvu de la grandiloquence caractéristique des grandes manifestations sportives internationales, témoigne des contraintes logistiques et financières auxquelles la Russie est confrontée.
Face à cette sobriété cérémonielle, qui pourrait potentiellement nuire à l'efficacité de la stratégie de communication du Kremlin, les autorités russes ont opté pour une approche médiatique axée sur la diffusion de messages forts, reléguant la cérémonie elle-même au rang de simple support visuel. Cette tactique vise à maximiser l'impact propagandiste de l'événement, tout en minimisant les aspects potentiellement moins impressionnants de sa mise en scène.
L'absence physique de Vladimir Poutine, compensée par une participation à distance, s'inscrit dans une logique de gestion de l'image du leader russe, tout en maintenant son association étroite à l'événement. (Figure 6) Cette approche permet de préserver le prestige présidentiel tout en assurant une présence symbolique forte, illustrant la capacité du régime à projeter son influence malgré les contraintes géopolitiques actuelles.
Les Jeux des BRICS revêtent une importance stratégique cruciale dans la consolidation politique de cette alliance, transcendant leur dimension purement sportive. Cet événement agit comme un catalyseur dans le renforcement des liens intra-BRICS et dans la cristallisation d'une identité collective, positionnée en contrepoint des valeurs occidentales. Dans cette configuration, la Fédération de Russie émerge comme un acteur pivot, démontrant sa capacité à fédérer des États aux trajectoires politico-économiques hétérogènes autour d'une vision commune du sport et des relations internationales. La cérémonie d'ouverture des Jeux des BRICS a été orchestrée comme une démonstration symbolique de l'influence géopolitique croissante de cette alliance. La parade des drapeaux, incluant non seulement les nations émergentes mais aussi des pays occidentaux, visait à projeter une image d'inclusivité et de rayonnement global transcendant les clivages traditionnels entre pays développés et émergents, tout en positionnant les BRICS comme un pôle d'attraction diplomatique et sportif alternatif à l'ordre établi.
L'organisation et la promotion de ces Jeux par Moscou s'inscrivent dans une stratégie géopolitique plus vaste, dépassant le cadre sportif pour façonner une alternative systémique à l'ordre international établi. Cette initiative vise à promouvoir un modèle de coopération entre puissances émergentes, tentant de s'affranchir des normes et institutions dominées par l'Occident. Ainsi, cet événement participe à la métamorphose des BRICS, les faisant évoluer d'un simple groupement économique vers un véritable pôle d'influence global, au sein duquel la Russie ambitionne d'assumer un rôle moteur.
Cette démarche s'inscrit dans le contexte plus large de la contestation de l'hégémonie occidentale et de la promotion d'un ordre mondial multipolaire, comme souligné dans la déclaration finale du Sommet de Johannesburg. Elle reflète la volonté des BRICS de construire un "multilatéralisme inclusif" et d'accroître la représentation des marchés émergents et des pays en développement dans les organisations internationales.
La construction d'un récit national de résilience et de grandeur
L'instrumentalisation du soft power russe, notamment à travers l'organisation des Jeux des BRICS, s'inscrit dans une stratégie multidimensionnelle qui dépasse le cadre purement géopolitique pour s'ancrer profondément dans la construction narrative nationale. Cette initiative s'articule comme un vecteur de consolidation identitaire et de légitimation du pouvoir en place, dans un contexte de tensions internationales exacerbées.
La résonance domestique des efforts de projection d'influence internationale de la Russie participe à l'élaboration d'un récit national sophistiqué. Ce narratif, savamment orchestré, vise à renforcer la cohésion sociale et à affirmer la résilience du pays face aux pressions extérieures. L'organisation des Jeux des BRICS, en particulier, est présentée comme une démonstration de la capacité de la Russie à maintenir son statut de puissance mondiale et à proposer des alternatives aux institutions dominées par l'Occident.
L'instrumentalisation de l'image du dirigeant du Kremlin s'inscrit dans une stratégie de communication politique sophistiquée, visant à façonner la perception publique et à consolider son autorité auprès de la population russe. Cette approche pédagogique ciblée utilise la figure présidentielle comme vecteur principal de transmission idéologique et de légitimation du pouvoir.
Vladimir Poutine se positionne délibérément comme l'architecte et le garant de la renaissance de la puissance russe, incarnant un éthos politique soigneusement construit autour des notions de force, de providence et de génie stratégique. Cette mise en scène médiatique élaborée vise à renforcer la cohésion nationale autour d'un narratif de restauration de la grandeur historique de la Russie, tout en justifiant la continuité du régime face aux pressions extérieures.
La mobilisation du sentiment patriotique autour de projets fédérateurs, tels que les Jeux des BRICS, s'inscrit dans une démarche de transcendance des clivages internes. Cette approche s'appuie sur la promotion d'un conservatisme érigé en "idée nationale", fusionnant les dimensions religieuse et morale pour renforcer la cohésion sociale dans un contexte de pressions extérieures. C’est dans ce but qu’un site officiel des jeux des BRICS sera mis en ligne pour permettre à tous de suivre cet événement. Il suit tous les standards occidentaux, avec une mascotte, une cérémonie d’ouverture, des objets dérivés, des volontaires et bénévoles pour l’organisation, des images des sportifs, des présentations, des vidéos, des spectateurs, une application mobile et bien entendu un tableau des médailles. L’illusion est parfaite et travaillée le tout réalisé dans un temps record.
L'organisation d'événements internationaux comme les Jeux des BRICS sert de vitrine à l'efficacité et à la vision stratégique du leadership actuel. En démontrant la capacité de la Russie à maintenir son prestige international malgré un environnement géopolitique hostile, le régime cherche à justifier sa continuité et à légitimer son autorité. Cette démonstration de compétence s'inscrit dans la logique de la "verticale du pouvoir" instaurée par Poutine, visant à centraliser l'autorité et à réaffirmer le contrôle de Moscou sur l'ensemble du territoire. Cette puissance est montrée par les résultats et l’écrasante puissance russe qui domine le débat sportif et rend la population fière de ses sportifs et de son dirigeant à l’origine de cet événement.
Afin de valoriser les performances exceptionnelles de ses athlètes, le gouvernement russe a, par décret, alloué un montant total de 274,7 millions de roubles pour récompenser les médaillés des Jeux BRICS 2023, qui se sont déroulés à Kazan du 12 au 23 juin. La délégation russe s'est imposée avec éclat, affichant un tableau des médailles impressionnant : 266 médailles d'or, 142 médailles d'argent et 101 médailles de bronze.
Le barème des récompenses a été fixé de manière précise : chaque médaille d'or est assortie d'une prime de 358 400 roubles, chaque médaille d'argent de 179 200 roubles, et chaque médaille de bronze de 107 500 roubles. Ces primes s'appliquent cumulativement, permettant ainsi aux athlètes ayant remporté plusieurs distinctions de percevoir une récompense pour chacune de leurs médailles, conformément à ce barème.
Cette initiative traduit la volonté des autorités russes de souligner l'importance du succès sportif dans les compétitions internationales, en particulier celles impliquant les nations des BRICS, et illustre leur engagement à soutenir et honorer les efforts de leurs représentants sportifs.
Cette initiative, savamment orchestrée, vise à repositionner la Russie sur l'échiquier mondial tout en renforçant la cohésion interne et la légitimité du régime. L'ampleur des investissements consentis et la mise en scène élaborée de cet événement témoignent de l'importance accordée par le Kremlin à cette démarche de diplomatie sportive.
Cependant, l'efficacité réelle de cette stratégie et la véracité des informations diffusées dans ce cadre méritent une analyse approfondie. Il convient désormais d'examiner l'impact tangible de cette initiative de soft power, tant sur la scène internationale que sur l'opinion publique russe. Cette évaluation nécessite une approche critique, prenant en compte les potentielles disparités entre la narration officielle et la réalité des faits.
Évaluation multidimensionnelle des Jeux des BRICS : « Entre rhétorique et réalité »
Les Jeux des BRICS sont présentés comme un outil de diplomatie sportive et un vecteur de soft power pour la Russie. Nous nous sommes attachés jusqu’à présent à présenter les stratégies russes sur un plan international et national. Il est nécessaire maintenant d’en effectuer une évaluation impartiale, en dépassant les discours officiels. Nous allons donc confronter les affirmations émanant des autorités russes et des organisateurs à des données indépendantes, tout en analysant leur réception internationale et leurs retombées géopolitiques concrètes.
L'analyse du site officiel des Jeux des BRICS révèle une adhésion manifeste aux standards de communication internationaux, traditionnellement associés aux événements sportifs occidentaux. La plateforme, disponible en plusieurs langues dont l'anglais et le français, témoigne d'une volonté d'accessibilité globale, paradoxalement en contradiction avec l'ambition affichée de s'émanciper des autorités sportives occidentales.
L'architecture et la présentation du site s'inscrivent dans la continuité des précédentes expériences russes en matière d'organisation d'événements sportifs majeurs, notamment les Jeux Olympiques de Sotchi et la Coupe du Monde de football. Cette approche reflète un dilemme stratégique pour le pouvoir russe : d'une part, la nécessité de se différencier des institutions sportives occidentales, et d'autre part, l'impératif de répondre aux attentes d'une population habituée aux standards internationaux des grands événements sportifs.
Selon les déclarations officielles, 97 nations ont confirmé leur participation, témoignant d'une ambition d'envergure mondiale pour cet événement.
M. Dmitry CHERNYSHENKO, en sa qualité Vice-Premier ministre de Russie, a affirmé l'engagement des autorités à garantir un niveau d'excellence dans l'organisation et le déroulement des compétitions.
Sur le plan financier, le ministère des Finances précise avoir alloué un budget conséquent de 1,29 milliard de roubles pour l'organisation des Jeux. En référence, pour les jeux Olympiques de Sotchi ce sont 3567 milliards de Roubles qui avaient été mis sur la table soit 2765 fois plus pour les JO. L’écart abyssal montre les difficultés financières de la Russie qui actuellement est sous le coup de sanction internationale et en économie de guerre. Comme pour Sotchi, une politique incitative a été mise en place, promettant des récompenses pécuniaires aux athlètes médaillés. Pour comparer les médaillés d’or, s’ils ont touché 358 400 roubles pour les jeux des BRICS, c’est 4 millions de roubles qui avaient été distribués pour les jeux olympique de Sotchi. Là encore l’écart est significatif.
L'analyse critique des données quantitatives communiquées officiellement concernant les Jeux des BRICS révèle des disparités significatives par rapport aux standards des événements sportifs internationaux majeurs.
La revendication de 10 000 billets vendus, présentée comme un succès, apparaît ridicule en comparaison des 12 millions de billets écoulés pour les Jeux Olympiques de Paris. Cette différence d'échelle souligne le défi considérable auquel sont confrontés les Jeux des BRICS pour atteindre une envergure comparable aux événements sportifs mondiaux établis.
Notons l’absence de public et le désert qui règne dans les différents lieux présentés. Cela contraste encore une fois avec les images des Jeux Olympiques de Paris 2024 où la foule des visiteurs a marqué tous les esprits.
Le partenariat médiatique avec Likee et la campagne hashtag #BRICS2024 illustrent une tentative d'engagement numérique. Cependant, les 13 millions de vues revendiquées en deux semaines et la participation de 54 000 personnes à travers le pays semblent modestes au regard des standards actuels de viralité sur les réseaux sociaux. À titre comparatif, une seule performance d'un athlète de renom comme Léon Marchand peut générer plus d'un million de vues, soulignant l'écart de notoriété et d'intérêt médiatique.
Les chiffres d'audience annoncés par Vladimir Leonov, ministre des Sports de la République du Tatarstan, font état de 41 millions de téléspectateurs. Bien que non négligeable, ce chiffre est éclipsé par les 5 milliards de téléspectateurs des Jeux Olympiques de Paris, représentant 84% de l'audience mondiale potentielle. L'aveu de l'impact négatif de la simultanéité avec la Coupe d'Europe de football révèle les difficultés de positionnement des Jeux des BRICS dans un calendrier sportif international saturé et sonne comme un aveu d’échec.
Sur le plan sportif, l'analyse des performances révèle un niveau global inférieur aux standards internationaux, à l'exception notable des athlètes russes et biélorusses. L’absence remarquable des athlètes chinois sur le devant de la scène montre également le peu d’intérêts porté par la Chine pour briller aux jeux des BRICS.
Pour illustrer le niveau de compétitivité des Jeux des BRICS, l'exemple emblématique d'Aleksandr Maltsev, médaillé d'or en natation synchronisée en l'absence de tout concurrent, constitue une image saisissante du manque de densité sportive observé lors de cet événement. (Figure 16) Cette anecdote, bien que symbolique, reflète les limites de ces Jeux à mobiliser une élite athlétique internationale et à offrir des compétitions véritablement disputées.
Cependant, un fait notable émerge : la performance remarquable de l'athlète russe Reikhan Kagramanova dans l'épreuve du 10 000 mètres marche. Avec un temps de 41:57.80, elle réalise la meilleure performance mondiale de l'année 2024, frôlant de moins de deux secondes le record du monde de la discipline. Cette performance isolée souligne le potentiel de certains athlètes russes à rivaliser au plus haut niveau, tout en mettant en lumière la rareté des faits d'excellence sportive durant ces Jeux.
Ces deux faits opposés, l'absence de concurrence dans certaines disciplines et l'excellence individuelle dans d'autres, illustrent le contraste marquant et les défis structurels auxquels les Jeux des BRICS sont confrontés pour s'imposer comme un événement sportif international de référence.
L'analyse critique des Jeux des BRICS révèle une dichotomie marquée entre les ambitions géopolitiques russes et la réalité de l'événement. Conçus comme un instrument de soft power et de diplomatie sportive, ces Jeux illustrent les défis auxquels la Russie fait face dans sa quête de réaffirmation sur la scène internationale. L'adhésion paradoxale aux standards de communication occidentaux, malgré une volonté d'émancipation, souligne un dilemme stratégique. Les données quantitatives - 10 000 billets vendus, 41 millions de téléspectateurs revendiqués, et un budget de 1,29 milliard de roubles - bien qu'importantes, pâlissent en comparaison des événements sportifs majeurs établis. La participation annoncée de 97 nations, bien que significative diplomatiquement, est nuancée par un niveau de compétition globalement inférieur aux standards internationaux, illustré par des cas emblématiques comme celui d'Aleksandr Maltsev, médaillé d'or sans concurrent. En somme, les Jeux des BRICS, malgré leur symbolique géopolitique, peinent à s'imposer comme une alternative crédible aux compétitions internationales établies, reflétant les tensions entre l'ambition russe de créer des institutions alternatives et la nécessité de s'aligner sur des standards globaux pour assurer légitimité et attractivité.
Une démarche géopolitique complexe
Depuis l'ère de la Guerre Froide, le sport a été instrumentalisé comme un vecteur d'influence, et les Jeux des BRICS s'inscrivent dans cette tradition, tout en reflétant les spécificités du paysage géopolitique contemporain.
L'instrumentalisation du soft power russe à travers cet événement se manifeste à plusieurs niveaux. Premièrement, les Jeux offrent une plateforme pour contester l'hégémonie occidentale dans la gouvernance sportive mondiale, en proposant une alternative aux institutions traditionnelles. Deuxièmement, ils servent de catalyseur pour renforcer la cohésion et l'identité collective au sein du bloc BRICS, en promouvant un modèle de coopération Sud-Sud. Troisièmement, ils contribuent à la construction d'un récit national de résilience et de grandeur, visant à consolider le soutien interne et à légitimer le pouvoir en place.
Cependant, une évaluation critique des données objectives révèle des limites significatives à l'efficacité de cette stratégie. L'adhésion aux standards de communication occidentaux, les disparités en termes de participation et d'audience par rapport aux grands événements sportifs, ainsi que le niveau de compétition globalement plus faible, témoignent des défis structurels auxquels sont confrontés les Jeux des BRICS. L'analyse comparative des budgets alloués aux Jeux des BRICS et aux Jeux Olympiques, par exemple, met en évidence les contraintes financières auxquelles la Russie doit faire face, dans un contexte de sanctions économiques et d'engagement militaire en Ukraine. De même, les données relatives aux audiences télévisées et à l'engagement sur les réseaux sociaux indiquent un intérêt limité au-delà des pays participants, remettant en question la capacité des Jeux à projeter une image positive de la Russie à l'échelle globale.
En dépit de ces limites, l'initiative des Jeux des BRICS ne doit pas être sous-estimée. Elle témoigne d'une volonté persistante de la Russie de maintenir son influence sur la scène internationale et de nouer des alliances stratégiques avec les pays émergents. La mobilisation de 97 nations participantes, même si l'engagement effectif de certaines de ces nations reste à nuancer, démontre un certain potentiel diplomatique et la capacité de Moscou à fédérer des acteurs autour d'une vision alternative de l'ordre mondial.
Cette ascension pose un défi stratégique majeur pour le bloc occidental, notamment l'Union européenne, qui se trouve contrainte de recalibrer son approche diplomatique et économique.
Régis Condette (MSIE45 de l’EGE)