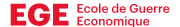Depuis plusieurs années, le Groenland, immense territoire recouvert de glaces et administré par le Danemark, a acquis une visibilité croissante dans la presse. Longtemps ignorée ou considérée comme une zone périphérique par les grandes puissances comMe la France 1, cette île-continent est désormais au cœur d’un tempête informationnelle où se mêlent enjeux climatiques, ambitions économiques, souveraineté politique et rivalités internationales. La conjoncture actuelle met en lumière l’ensemble des facteurs qui expliquent cette focalisation : la fonte accélérée de la banquise arctique suscite l’attrait de nouvelles routes maritimes plus courtes entre l’Asie et l’Europe ; le potentiel minier et pétrolier du sous-sol groenlandais (voir photo annexe 1) aiguise l’appétit de puissances en quête de ressources ; enfin, la militarisation progressive de l’Arctique, motivée par des considérations de sécurité, aboutit à une confrontation médiatique féroce pour le contrôle de cette zone polaire.
Les données du problème
Le Groenland, qui dispose depuis 1979 d’un statut d’autonomie renforcé en 2009, demeure sous la souveraineté du Danemark pour tout ce qui touche à la diplomatie et à la défense. En apparence, Copenhague resterait donc le seul interlocuteur légitime pour les dossiers stratégiques relatifs à l’île. Pourtant, la situation est plus complexe car le contrôle de cet espace permettrait a celui qui en a la charge d’avoir un pouvoir d’influence sur le Commerce Mondial et les relations internationales. Aucune des grandes puissances de notre monde, que ce soit les Etats Unis, la Russie ou la Chine ne peut y rester indifférent.
Donald Trump, dès sa première investiture en 2019 2, a multiplié les déclarations laissant entendre qu’il souhaitait acquérir le Groenland ou, au minimum, imposer une mainmise économique et militaire sur l’île. Ses propos ont suscité l’indignation immédiate des autorités danoises mais ont imposé cette question dans le débat public. Dans le même temps, la Chine avance ses « Nouvelles routes de la soie » jusque dans les eaux polaires, tandis que la Russie, puissance historique de l’Arctique, perfectionne son propre récit pour légitimer ses ambitions dans cette zone.
Loin de se limiter à un duel Washington–Copenhague, la situation s’inscrit dans un contexte plus vaste, celui de la « bataille des récits » qui oppose les États-Unis, la Russie et la Chine pour l’appropriation discursive et stratégique de l’Arctique. La Russie, en particulier, s’emploie depuis le début des années 2000 à reconquérir son statut de « puissance polaire » : elle modernise ses bases militaires, déploie la plus grande flotte de brise-glaces au monde et promeut l’image d’un Arctique légitimement russe, ancré dans son histoire.
Les États-Unis, soucieux de contrer Moscou comme Pékin, considèrent le Groenland comme une pièce maîtresse dans la sécurisation de leur flanc nord. Quant au Danemark, il se retrouve à défendre son autorité sur l’île et à gérer la posture nuancée du gouvernement local groenlandais, lequel souhaite bénéficier de nouveaux investissements sans sacrifier son autonomie. Nous proposons, dans cet article, d’éclairer la dimension « guerre de l’information » dans ce dossier en trois parties distinctes qui correspondent aux lignes de force du phénomène : les intérêts concrets autour du Groenland, les communications de Donald Trump, et la riposte du Danemark. Chacune de ces parties s’accompagne d’une mise en perspective élargie, afin de mieux comprendre comment la Russie, en toile de fond, exacerbe la compétition narrative et la surenchère discursive dans l’Arctique.
Pourquoi le Groenland ?
Comme l’a rappelé par Camille Escudé-Joffres0: « L’Arctique n’est pas une des cinq régions retenues par les Nations-Unies dans leur division du monde. Dans le découpage de l’ONU, les régions arctiques sont divisées entre Amérique, Asie et Europe, remettant en cause une possible unité de l’Arctique ».
Le Groenland s’étend sur plus de deux millions de kilomètres carrés et demeure recouvert en grande partie par la calotte glaciaire. Pourquoi donc se trouve t’il de nouveau sur le devant de la scène médiatique après la réélection de Donald Trump ? Tout d’abord car malgré ces conditions extrêmes, il recèle un potentiel économique considérable. Plusieurs rapports suggèrent la présence de ressources minières et énergétiques indispensables aux hautes technologies et à la transition énergétique : terres rares, uranium, métaux critiques, zinc ou hydrocarbures offshore 3. Même si l’extraction demeure coûteuse, la perspective de pénuries globales de matières premières et de rivalités autour des énergies fossiles fait de l’île un territoire d’avenir, si la fonte de la banquise en facilite l’accès. Dans un contexte où la Russie exploite abondamment l’Arctique pour ses propres réserves, où la Chine s’active pour sécuriser ses approvisionnements, les États-Unis ne veulent pas être relégués au second plan. Ce qui était autrefois un théâtre marginal devient ainsi un espace convoité, d’autant plus attractif que la transformation climatique rend plus praticables les côtes groenlandaises.
L’autre facteur majeur est la reconfiguration des routes maritimes polaires. Le réchauffement climatique ouvre la perspective d’un passage arctique direct, plus court d’au moins 40% par rapport aux voies traditionnelles (Suez, Malacca) pour relier l’Asie à l’Europe4. Cette possibilité n’en est encore qu’au stade théorique, mais elle suscite déjà l’intérêt des armateurs et des multinationales. La Russie, en développant sa « route maritime du Nord » 5 le long de ses côtes, entend tirer parti de sa flotte de brise-glaces et de ses infrastructures portuaires pour capter une partie du trafic. La Chine, de son côté, évoque sa « Route de la soie polaire » 6 et se prépare logistiquement à exploiter ce raccourci entre l’Atlantique et le Pacifique. Les États-Unis redoutent qu’un rival ne vienne contrôler cette nouvelle voie, voire installer des bases navales dans des zones arctiques stratégiques. Le Groenland, par sa position centrale au nord de l’océan Atlantique, pourrait jouer le rôle de pivot logistique pour surveiller ou protéger ces routes émergentes. C’est l’une des raisons pour lesquelles Donald Trump compare la région à un nouveau canal de Panama, persuadé qu’un adversaire pourrait acquérir une longueur d’avance si Washington ne réagit pas.
Le troisième élément décisif est la base de Thulé (Thule Air Base) 7, située au nord-ouest du Groenland. Héritée de la Guerre froide, elle constitue une pièce essentielle du dispositif antimissile américain, notamment pour détecter et gérer d’éventuelles menaces de missiles balistiques. Cet aspect stratégique n’a pas échappé à Moscou. La Russie, depuis le début des années 2000, cherche à consolider sa défense dans l’Arctique, par la modernisation de ses installations et l’affirmation d’un discours patriote qui souligne son rôle historique dans la région. Elle considère toute progression américaine comme une tentative de remise en cause de son statut de « puissance arctique » légitime. Washington, en retour, veut s’assurer que personne ne contestera son accès à la base de Thulé ou ne menacera ses lignes de ravitaillement. La militarisation de l’Arctique devient ainsi un enjeu mondial qui dépasse la seule question du Groenland, mais dans lequel cette île occupe une place tout à fait significative, au même titre que les archipels russes ou canadiens qui jalonnent l’océan Arctique. On comprend, dès lors, comment la conjonction de ces quatre facteurs (absence d’unité arctique, ressources stratégiques, les nouvelles routes et leur impact sur le commerce mondial et la position militaire) a suffi à attirer l’attention de l’Aigle, l’Ours et le Dragon et à transformer un territoire isolé en symbole de la rivalité géopolitique contemporaine.
La stratégie cachée derrière le projet “Trump” sur le Groenland
Depuis l’été 2019 8, la presse a commencé à faire état de fuites médiatiques évoquant l’éventualité selon laquelle Donald Trump envisagerait d’ « acheter » le Groenland. À ses débuts, ces informations suscitaient des réactions partagées : certains y voyaient une provocation excentrique, un simple coup de com’ destiné à attirer l’attention, tandis que d’autres interprétaient ces déclarations comme l’expression d’une volonté stratégique profonde. En effet, derrière ce projet apparemment extravagant se cachait une logique cohérente, ancrée dans les grands principes qu’exprimait déjà Trump dans The America We Deserve (2000). Ce livre, bien qu’il ne traite pas du Groenland, dévoile une vision d’un État fort et souverain, capable de négocier à la manière des grands deals immobiliers et de se montrer intransigeant sur la défense de ses intérêts économiques et sécuritaires.
Dans le cas du Groenland, l’idée d’un « rachat » ne saurait être interprétée comme une simple lubie, mais comme l’aboutissement d’une stratégie de guerre de l’information visant à saturer l’espace médiatique de déclarations provocatrices. Loin d’être un simple coup médiatique, elle vise à imposer dans l’agenda international l’idée que le Groenland est un “territoire contestable”, alors même qu’il est administré par le Danemark. Trump, en se positionnant sur ce dossier, ne cherche pas uniquement à surprendre, il veut également forcer la main à Copenhague, créer un climat d’urgence et inciter les alliés à réagir rapidement. À travers des formules chocs, il présente cette opération comme une opportunité pour les États-Unis d’exploiter pleinement le potentiel inexploité du Groenland – un territoire dont le sous-sol recèle, selon de nombreux rapports, des ressources minières et énergétiques d’un intérêt crucial pour la transition énergétique mondiale. Dans cette optique, la proposition de « deal » se veut comparable à une grande opération immobilière, où l’on part d’une offre extrême afin de contraindre l’adversaire à céder sur des points plus modestes, notamment en matière de concessions sécuritaires et économiques.
La rhétorique de Trump, particulièrement agressive dans ce dossier, sert à polariser le débat : tout acteur qui s’y oppose doit se justifier, tandis que celui qui l’avance occupe une place de choix dans l’espace médiatique. Elle se décline en deux volets complémentaires. D’une part, il adopte une posture de négociateur en affirmant que le Danemark, le présentant ainsi comme “passif” avec ses moyens limités, est incapable d’exploiter le plein potentiel du Groenland et le délaisse. Il soutient que les États-Unis, grâce à leur puissance économique et leur savoir-faire, pourraient transformer l’île en un véritable moteur de croissance, capable de générer des retombées positives pour la population locale et renforcer la sécurité nationale. D’autre part, il durcit progressivement son discours 9 en évoquant clairement la menace que représentent la Russie et la Chine dans le Grand Nord. En multipliant les références à la modernisation militaire de Moscou, à la revitalisation de ses bases et à sa flotte de brise-glaces – éléments qui témoignent de l’ambition russe de s’affirmer comme la « puissance arctique » par excellence – Trump parvient à cristalliser l’idée que, sans une intervention américaine ferme 10, le Groenland et toute la region arctique pourrait tomber sous l’emprise de concurrents hostiles.
Il importe de souligner que cette stratégie ne se limite pas à un simple appel à la défense nationale. Elle s’inscrit dans une logique plus large, celle de la polarisation de l’opinion publique américaine. Le président utilise, en effet, des expressions et des comparaisons fortes : il compare l’Arctique à un nouveau canal de Suez ou de Panama 11, ce qui suggère qu’un passage maritime stratégique pourrait révolutionner les échanges internationaux si une grande puissance, qu’elle soit russe ou chinoise, venait à le contrôler. Par ailleurs, Trump insiste sur la « passivité » de Copenhague, dénonçant le manque de moyens déployés par le Danemark pour protéger le Groenland et laissant entendre que, faute d’une action immédiate, un autre acteur – en l’occurrence la Russie – pourrait s’installer dans la région. Cette surenchère verbale, diffusée massivement sur les réseaux sociaux et relayée par les médias internationaux, sert non seulement à mobiliser la base électorale nationaliste américaine, mais aussi à imposer un récit selon lequel la sécurité des États-Unis dépendrait d’une présence continue et affirmée dans le Grand Nord.
La recherche d’une légitimité extérieure et intérieure
Les grands principes défendus par Trump dans The America We Deserve réapparaissent ici sous une forme transformée et adaptée à l’enjeu arctique. Dans son ouvrage, il prône une Amérique forte, capable de conclure des deals audacieux et de se montrer intransigeante face aux menaces extérieures. Cette philosophie se retrouve dans sa stratégie autour du Groenland, où il utilise la proposition d’un rachat – certes symbolique – pour renforcer son image de négociateur impitoyable et de défenseur des intérêts américains. Il ne s’agit pas simplement de faire sensation, mais de créer un environnement où l’opinion publique, tant nationale qu’internationale, se voit confrontée à la possibilité d’un déséquilibre stratégique si Washington ne réagit pas promptement. Cette dynamique de « tout ou rien » est typique de la méthode Trump, qui aime imposer son agenda par des déclarations percutantes, quitte à recourir à des comparaisons hyperboliques pour galvaniser ses partisans.
Cependant, le récit de Trump ne s’inscrit pas dans un vide. En arrière-plan de cette stratégie se trouve la construction discursive opérée par la Russie dans l’Arctique. Depuis le début des années 2000, Moscou déploie une série d’actions visant à revendiquer sa légitimité dans le Grand Nord. La Russie modernise ses infrastructures, déploie une flotte de brise-glaces qui demeure inégalée, et multiplie les expéditions scientifiques et les cérémonies symboliques, telles que la plantation de drapeaux sous la banquise ou la prise de présidence du Conseil de l’Arctique en 2021. Ces gestes, soigneusement orchestrés et relayés par la presse d’État, font partie d’une stratégie de communication visant à ancrer l’idée que l’Arctique est, par nature et par histoire, un espace relevant de la sphère d’influence russe. En cultivant cette image, la Russie cherche à s’imposer comme le garant de la stabilité et de la sécurité dans une région que les États-Unis craignent de voir ébranlée par une montée en puissance concurrente.
Ainsi, la rhétorique de Trump se nourrit de cette tension préexistante. En soulignant que, sans une présence renforcée des États-Unis, l’Arctique pourrait tomber sous la coupe de Moscou ou de Pékin, il exploite non seulement la peur de la domination russe, mais aussi celle d’un déséquilibre géopolitique global qui mettrait en péril l’hégémonie américaine. Cette stratégie a pour effet de polariser le débat, forçant le Danemark à répondre pour ne pas apparaître passif, et de mobiliser l’opinion publique sur la nécessité d’un engagement militaire et économique sans faille dans le Grand Nord. L’ensemble de ces prises de position constitue une véritable guerre de l’information, où chaque déclaration, chaque tweet et chaque intervention médiatique s’inscrit dans une logique de confrontation symbolique et stratégique.
Sur le plan intérieur, cette approche permet à Trump de renforcer sa base électorale nationaliste, fidèle à la devise « Make America Great Again ». L’idée qu’il serait « absurde » de laisser la Russie ou la Chine imposer leur volonté dans l’Arctique résonne avec une vision de l’Amérique forte et souveraine, prête à utiliser tous les moyens – qu’ils soient économiques ou militaires – pour protéger ses intérêts. Ce discours, bien que perçu par certains comme exagéré, s’inscrit dans la continuité de ses précédentes positions, où la force et la négociation audacieuse sont présentées comme les clés d’une politique étrangère efficace. Par ce biais, il transforme le Groenland en un symbole de la lutte pour la suprématie mondiale, où chaque territoire, chaque route maritime et chaque installation militaire représente un enjeu vital pour la sécurité nationale.
L’aspect stratégique de cette communication repose également sur un calcul précis: en forçant Copenhague à réagir face à ses velléités, Trump vise à obtenir des concessions concrètes – que ce soit en termes d’installations militaires renforcées, d’accès privilégié aux ressources minières ou de clauses interdisant aux autorités groenlandaises d’accepter des investissements de concurrents comme la Chine. Ce double objectif, à la fois symbolique et tangible, reflète la manière dont il a toujours envisagé les grands deals, ceux qui reposent sur l’art de la provocation et de la négociation simultanée.
La riposte danoise
Face aux annonces répétées de Trump, la réaction de Copenhague a été immédiate et ferme. En 2019, la Première ministre du Danemark a qualifié l’idée d’« absurde » 12 dès la première mention de cette proposition, indiquant qu’il n’était pas question de « vendre » un territoire habité disposant d’une autonomie. Plus récemment, un euro député Danois se “lache” 13 face à la rhétorique du nouveau président réélu. Le ministère des Affaires étrangères danois a souligné, à plusieurs reprises, que le Groenland n’était pas un bien négociable et qu’il relevait du Royaume du Danemark 14. Pour autant, le gouvernement s’est rapidement rendu compte que ce simple rejet rhétorique ne suffirait pas à contrer la vague médiatique et qu’il fallait, en parallèle, consolider la présence danoise au Groenland. Le Danemark a donc pris plusieurs initiatives visant à montrer qu’il ne restait pas inactif, ni militaire ni politiquement 15.
La défense et l’affirmation de la souveraineté ont constitué la première ligne de la riposte : Copenhague a annoncé l’envoi de navires de guerre pour patrouiller dans les eaux groenlandaises, le déploiement de drones de surveillance et le renforcement du dispositif de formation des soldats spécialisés dans le froid polaire. S’il ne s’agit pas de contrer frontalement la puissance militaire américaine, ces décisions visent à rappeler que le Danemark remplit ses obligations de protection vis-à-vis de l’île et qu’il n’a pas l’intention de déléguer sa défense à d’autres États. Les diplomates danois ont également multiplié les contacts avec l’OTAN, l’Union européenne et les États-Unis pour désamorcer les tensions, rappelant que l’alliance atlantique – dont fait partie le Danemark – offre déjà un cadre de sécurité suffisant pour l’Arctique. Par ce biais, Copenhague cherchait à couper l’herbe sous le pied à Donald Trump, qui présentait la situation comme si le Groenland était délaissé ou vulnérable.
Le second axe de la riposte s’est focalisé sur l’autonomie groenlandaise 16. Depuis le renforcement de son statut en 2009, le gouvernement local de Nuuk peut négocier pour divers sujets relevant de la gestion des ressources, de l’économie ou de la politique intérieure. Or, le Groenland lui-même est intéressé par des coopérations économiques, qu’elles soient américaines, chinoises ou d’ailleurs, pour développer l’extraction minière, moderniser des infrastructures ou attirer des partenaires étrangers. Le Danemark redoute qu’un investissement direct de la Chine (ou des États-Unis) ne conduise à une perte de contrôle sur l’île. Par conséquent, Copenhague s’est employé à encadrer plus strictement les projets susceptibles de dépasser la simple compétence locale. Le gouvernement groenlandais, de son côté, s’est montré prudent. Il ne rejette pas totalement l’idée de coopérations économiques avec Washington, pékin, Moscou ou d’autres acteurs, mais il refuse la perspective d’une « mainmise » américaine unilatérale. À cet égard, il a rappelé publiquement qu’une vente ou une cession de l’île n’entrait pas dans le cadre des négociations. Autrement dit, le Groenland a adopté une posture nuancée : profiter de la rivalité pour obtenir des investissements tout en évitant de perdre la maîtrise de sa décision politique. Depuis quelques années, l’île souhaite également multiplier ses partenaires : au lieu de dépendre uniquement du Danemark, elle entend jouer de la concurrence pour financer des infrastructures, extraire des terres rares et faire progresser son autonomie. En ce sens, la menace chinoise brandie par Donald Trump n’est pas toujours perçue au Groenland comme un risque, mais parfois comme une opportunité de diversification. Les Inuits, peuple autochtone, surveillent néanmoins tout accord susceptible de brader leurs droits ou de dénaturer leur environnement.
L’Union européenne s’est également positionnée dans le sillage danois 17. Même si le Groenland n’est plus membre de l’UE depuis 1985, Bruxelles soutient la souveraineté danoise par crainte d’une ingérence américaine qui affaiblirait la cohésion transatlantique ou créerait un précédent dangereux en termes de territoire d’un État membre. À l’échelle de la diplomatie européenne, c’est le respect du droit international et l’équilibre régional qui priment, surtout à l’heure où Bruxelles surveille les revendications russes au nord du cercle polaire. Les fonctionnaires européens redoutent qu’une vente, une cession ou un arrangement bilatéral passant au-dessus de la tête de Copenhague ne légitime, par voie de conséquence, certaines offensives diplomatiques sur d’autres territoires arctiques. Toutefois, l’UE ne dispose pas de moyens militaires autonomes suffisants pour appuyer le Danemark en cas de tension réelle. Cette dépendance stratégique à l’égard de l’OTAN (et donc des États-Unis) rend la position européenne délicate : elle soutient la souveraineté danoise, mais ne souhaite pas froisser l’allié américain dans un contexte où la Russie, depuis 2021 et sa présidence du Conseil de l’Arctique, s’emploie à consolider son influence dans la zone.
Une bataille de récits autour des enjeux stratégiques de l’Arctique
Si Donald Trump n’a pas concrétisé son idée d’ « acheter » le Groenland, la simple évocation de ce projet a suffi à placer l’île-continent au cœur d’une séquence intense de guerre de l’information. L’absurdité apparente de la proposition masquait en réalité un calcul, celui d’obtenir des concessions stratégiques (accès aux terres rares, facilités militaires, limitation d’investissements chinois) tout en affichant, aux yeux de l’opinion américaine, une détermination à « protéger l’Amérique » dans le Grand Nord. Le Danemark, contraint de répondre sous la pression médiatique, a opposé un refus catégorique et s’est empressé de réaffirmer sa souveraineté, tout en renforçant sa présence militaire mais hormis quelques communications, n’occupe que très peu la scène médiatique. Le Groenland, dans une posture plus nuancée, n’a cessé de souligner son droit à l’autonomie et son intérêt pour la diversification économique, mais demeure attentif à ne pas se faire déposséder. L’Union européenne, quant à elle, se retrouve en soutien discret du Danemark, ne pouvant tolérer qu’un État tiers dicte les règles sur un territoire lié à l’un de ses États membres, sans pour autant avoir la capacité de s’imposer dans la zone.
Au-delà de l’affrontement entre Washington et Copenhague, la Russie agit en toile de fond à travers sa propre politique arctique, qui se fonde sur une « construction discursive » dynamique 18. Depuis le début des années 2000, Moscou multiplie les expéditions médiatisées et les déclarations officielles soulignant ses droits historiques sur l’Arctique 19: elle plante un drapeau sous-marin au pôle Nord, modernise des bases polaires, brandit ses brise-glaces comme une force incontournable. La présidence tournante du Conseil de l’Arctique qu’elle a exercée en 2021 20 lui aurait permis de façonner l’agenda de la coopération régionale, tout en s’efforçant de convaincre l’opinion internationale que la Russie est un garant légitime de la sécurité et de la prospérité dans la zone mais la guerre en Ukraine a décalé ce projet. Cette propagande polaire s’accompagne également d’actions concrètes : revendications sur la dorsale de Lomonosov, manœuvres navales répétées, création d’un corridor maritime pour réduire la distance entre l’Atlantique et le Pacifique.
L’« affaire du Groenland » illustre la montée en puissance d’une véritable bataille de récits autour de l’Arctique. Les États-Unis pratiquent la saturation médiatique (discours tonitruants de Trump, menaces voilées de recours à la force, tweets ciblés). La Russie construit, depuis plus longtemps, un discours patriote et historique, soutenu par l’action concrète (bases, brise-glaces, forages). La Chine avance une rhétorique plus discrète, principalement économique (Route de la soie polaire), mais elle investit dans des projets portuaires ou miniers potentiellement stratégiques. Au centre de ces narrations concurrentes, le Danemark se retrouve à défendre la souveraineté formelle du Groenland, l’Union européenne cherche à maintenir la stabilité dans l’Arctique, et les Groenlandais eux-mêmes tentent de tirer profit de l’intérêt global pour leur île sans perdre le contrôle de leur autonomie.
La séquence lancée par Donald Trump n’aboutira peut-être pas à l’achat du Groenland, mais elle a obligé tous les acteurs à révéler, au moins partiellement, leur jeu. Le Danemark, intensifie sa surveillance et sa présence, tout en maintenant un dialogue prudent avec les autorités locales. Les États-Unis ont rappelé qu’ils ne laisseraient ni la Russie ni la Chine établir un monopole dans cette zone. La Russie, pour sa part, continue de consolider son influence arctique grâce à une communication savamment orchestrée et à une militarisation grandissante de son littoral polaire. Le Groenland, quant à lui, a saisi l’occasion de cette médiatisation pour revaloriser ses revendications économiques et politiques. Loin d’être close, la rivalité s’en retrouve renforcée par la « guerre de l’information » qui se jouera désormais à chaque nouvelle prise de position. Les brise-glaces russes, les tweets américains et les manœuvres diplomatiques danoises préfigurent une scène polaire où l’ingrédient médiatique tiendra vraisemblablement une place déterminante dans l’agenda du XXIe siècle.
Louis Heriard Dubreuil (MSIE 45 de l’EGE)
Sources
[0] Article « Les régions de l’Arctique entre États et sociétés », Géoconfluences, septembre 2019.
[1] SUD OUEST: Ségolène Royal : ses chiffres erronés sur l’activité de Michel Rocard à l’ambassade des poles, disponible sur: https://www.sudouest.fr/politique/segolene-royal/segolene-royal-ses-chiffres-errones-sur-l-039-activite-de-michel-rocard-a-l-039-ambassade-des-poles-2074190.php
[2] LE MONDE: Donald Trump confirme qu’il aimerait acheter le Groenland disponible sur: https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/19/donald-trump-confirme-qu-il-aimerait-acheter-le-groenland_5500637_3210.html
[3] Le télégramme: Groenland. Pourquoi tant de convoitise ? disponible sur: https://www.letelegramme.fr/monde/span-classamorcegroenland-spanpourquoi-tant-de-convoitise-3512107.php
[4] Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011–2020, publié en aout 2011 par le ministere des affaires etrangeres danoise pp18-19, disponible en ligne sur: file:///Users/louisheriarddubreuil/Downloads/Arctic-strategy.pdf
[5] KOSMONEWS: L’Arctique et la route du Nord, zone d’intérêt majeure de la Russie
disponible sur: https://kosmosnews.fr/2023/12/09/larctique-et-la-route-du-nord-zone-dinteret-majeure-de-la-russie/
[6] LE POINT: La Chine veut une "route de la Soie polaire" dans l'Arctique
[7] GRANDS ESPACES: Thulé Air Base, la sentinelle stratégique disponible sur: https://www.grands-espaces.com/decouvertes/thule-air-base-la-sentinelle-strategique/
[8] WALL STREET JOURNAL: President Trump Eyes a New Real-Estate Purchase: Greenland
disponible sur: https://www.wsj.com/articles/trump-eyes-a-new-real-estate-purchase-greenland-11565904223
[9] EURONEWS: Groenland, canal de Panama : Donald Trump n'exclut pas le recours à la force militaire, disponible sur: https://fr.euronews.com/2025/01/07/groenland-canal-de-panama-donald-trump-nexclut-pas-le-recours-a-la-force-militaire
[10] Trump refuses to rule out using military to take Panama Canal and Greenland
https://www.theguardian.com/us-news/2025/jan/07/trump-panama-canal-greenland
[11] Donald Trump vows to take Panama Canal and Greenland, disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=i6tU1PPQbKg
[12] Danish PM: Trump's Idea of Buying Greenland Is 'Absurd'
https://www.youtube.com/watch?v=cE5kAXmsrsw
[13] YOUTUBE: Cet eurodéputé danois n’a pas mâché ses mots contre Trump et ses ambitions au Groenland, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=FdxlGFdWQ6o
[14] YOUTUBE: Denmark's PM responds to Trump refusing to rule out taking control of Greenland, disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=p-qAIoZ2pdc
[15] BBC: Trump veut s'emparer du Groenland : Quatre façons dont cette saga pourrait se dérouler disponbile en ligne sur: https://www.bbc.com/afrique/articles/cgkj17vn0m3o
[16] DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES: Why would Greenlanders take a deal from Trump that gives them less than they already have? Disponible sur: https://www.diis.dk/en/research/why-would-greenlanders-take-a-deal-from-trump-that-gives-them-less-than-they-already
[17] EURONEWS: L'UE durcit sa position sur le Groenland alors que Trump réitère ses menaces expansionnistes disponible sur: https://fr.euronews.com/my-europe/2025/01/28/pret-a-se-defendre-lue-durcit-sa-position-sur-le-groenland-alors-que-trump-reitere-ses-men
[18] LE JOURNAL DU DIMANCHE: Développement dramatique de la situation» : la Russie réagit aux menaces d’annexion du Groenland de Trump, disponible sur: https://www.lejdd.fr/international/developpement-dramatique-de-la-situation-la-russie-reagit-aux-menaces-dannexion-du-groenland-de-trump-153684
[19] GEOCONFLUENCES: La Russie, puissance arctique contrariée dispoible sur https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-russie-des-territoires-en-recomposition/articles-scientifiques/puissance-arctique
[20] ARTIC COUNCIL: RUSSIAN CHAIRMANSHIP 2021-2023 disponible sur: https://arctic-council.org/about/previous-chairmanships/russian-chairmanship-2
Annexe 1: Les activités industrielles et les réserves d’hydrocarbures en Arctique
Pour aller plus loin:
THE AMERICA WE DESERVE by Donald Trump, 15 Janvier 2000
US GEOLOGICAL SURVEY.
Circum-Arctic Resource Appraisal : Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle, disponible sur : https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf
THE ARCTIC INSTITUTE.
Arctic Shipping Routes : Assessing the Potential for a 40 % Shorter Path disponible sur : https://www.thearcticinstitute.org/arctic-shipping-routes-40percent/
AGENCE ROSATOM.
Projet de développement de la route maritime du Nord. Disponible sur : https://rosatom.ru/en/northern-sea-route/
CONSEIL DES AFFAIRES D’ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE.
Livre blanc sur la politique arctique Disponible sur : http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm
BURNS, R.C.
Thule Air Base and US Missile Defense: Strategic Outpost of the Cold War to the Present Disponible sur : https://scholarworks.alaska.edu/handle/11122/ThuleDefense
RFI
Pourquoi le Groenland intéresse Trump ?, 27 janvier 2025, disponible sur : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-international/20250127-pourquoi-le-groenland-int%C3%A9resse-trump
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU DANEMARK.
Position du Danemark sur le statut du Groenland, 2025, disponible sur : https://um.dk/en/foreign-policy, page 18-19/ 58
THE ARTIC INSTITUTE
The Complexities of Arctic Maritime Traffic, By Rachael Gosnell, 30 janvier 2018
disponible sur: https://www.thearcticinstitute.org/complexities-arctic-maritime-traffic/
THE DANISH PARLIAMENT
Greenland and the Faroe Islands, updated 27/10/2021, disponible sur: https://www.thedanishparliament.dk/eu-information-centre/greenland-and-the-faroe-islands
BBC.COM
Trump veut s'emparer du Groenland : Quatre façons dont cette saga pourrait se dérouler
Disponible sur: https://www.bbc.com/afrique/articles/cgkj17vn0m3o