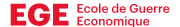Souvent perçue comme un délit mineur, la contrefaçon est principalement associée aux produits de luxe et bénéficie d’une certaine forme de tolérance dans l’esprit collectif. Pourtant, ce phénomène représente une menace bien plus importante, s’étendant à de nombreux secteurs : vêtements, jouets, médicaments, équipement médical, pièces détachées, logiciels, etc. Le trafic de biens contrefaits constitue non seulement un risque sérieux pour la santé et la sécurité des consommateurs, mais il engendre également des défis économiques et sociaux considérables. En France, les pertes liées à la contrefaçon sont estimées à 6,7 milliards d’euros par an, entraînant la suppression de 38 000 emplois.
Derrière ce phénomène se cachent des organisations criminelles transnationales qui trouvent dans la contrefaçon une source de financement parmi d’autres trafics illicites. Ces contrefacteurs exploitent les failles des systèmes de sécurité et s’organisent en réseaux de plus en plus sophistiqués, rendant la détection et la répression de leurs activités toujours plus complexes. Cette dynamique perpétuelle pose un défi croissant aux autorités douanières, qui font de la lutte contre ces trafics une priorité. Pour contrer efficacement ce fléau, l’innovation et d’adaptation des stratégies de lutte deviennent essentielles.
La France, deuxième pays le plus touché par la contrefaçon
La contrefaçon désigne toute forme de reproduction, d’imitation ou d’utilisation, qu’elle soit totale ou partielle, d’un bien protégé par des droits de propriété intellectuelle, sans l’accord de son titulaire. Cette pratique constitue une infraction pénale et s’applique notamment aux marques, dessin, brevets, logiciels et droits d’auteur. Elle s’accompagne souvent d’une volonté de faire croire que la copie est authentique, portant ainsi atteinte aux droits d’auteur.
La France est le deuxième pays le plus touché par la contrefaçon, après les États-Unis[i]. La qualité de ses produits, souvent associées au prestige de son image, rendent ces derniers particulièrement vulnérables aux copies et imitations. Ces dernières années, la contrefaçon a connu une forte croissance, favorisée par la mondialisation des échanges et le développement d’internet et du commerce en ligne. À l’échelle mondiale, elle représente 2,5% du commerce et touche tous les États européens qui, collectivement, perdent chaque année environ 15 milliards d’euros de recettes publiques. En France, les pertes s’élèvent à 6,7 milliards d’euros par an et entraînent la suppression de plus de 38 000 emplois[ii]. Cependant, ces données ne représentent qu’une partie du volume réel de la contrefaçon. Cette activité frauduleuse, qui consiste à copier ou imiter des produits originaux, rend difficile l’évaluation précise de son ampleur. Les estimations reposent principalement sur les données saisies par les douanes.
Certains secteurs sont plus fortement touchés par la contrefaçon que d’autres. Les secteurs des jouets, des jeux et des articles de sport occupent la première place parmi les produits contrefaits saisis en France, avec plus de 8 millions en 2023[iii]. Les articles d’emballage contrefaits suivent de près, avec plus de 4,7 millions d’articles retirés du marché. D’autres secteurs, comme les produits de soins corporels (6,50% des articles saisis), les vêtements et accessoires (5,71%) et les denrées alimentaires et boissons (5,62%), sont également impactés par la contrefaçon. Ils représentent près de 3,7 millions d’articles retirés du marché en France, en 2023[iv].
Les contrefaçons proviennent « pratiquement de toutes les économies de tous les continents »[v] indique un rapport de l’OCDE et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Cependant, l’Asie demeure la région centrale de production, avec la Chine comme principal acteur mondial. Le rapport cite également Hong Kong, Singapour et les Émirats arabe unis. Ces pays, qualifiés « d’économies bien développées à revenu élevé et d’importantes plateformes de commerce internationale », servent de points de transit pour les produits contrefaits[vi]. La Turquie se positionne comme deuxième exportateur mondial de contrefaçon. Ce marché prospère, alimenté par des ateliers clandestins, une forte demande touristique et une application limitée de la loi. En 2023, la douane française a intercepté plusieurs cargaisons en provenance de Turquie de pièces détachées contrefaites, jugées « hautement dangereuse », au port de Marseille. 80 000 pièces ont été récupérées en un an. Les contrefacteurs ont fabriqué des fausses pièces qu’ils ont fait passer pour des produits de marques reconnues comme Renault, Citroën, Peugeot, Corteco, Volkswagen-Audi et Mahle[vii].
La pandémie de COVID-19 a accéléré une tendance déjà présente : l’augmentation des ventes de produits contrefaits en ligne[viii]. Les confinements et les restrictions de déplacement ont poussé les consommateurs à privilégier les achats en ligne, créant un terrain favorable pour la prolifération de l’offre de contrefaçons. Internet offre aux contrefacteurs un espace anonyme, leur permettant de dissimuler tout en élargissant l’étendue et la variété de leurs produits.
Les douanes face aux contrefacteurs
Face à la montée croissante de la contrefaçon, la douane se positionne en première ligne dans la lutte contre ce trafic. En tant qu’administration publique responsable du flux des marchandises entrant et sortant du pays, elle remplit trois missions majeures : la régulation des échanges, le soutien à la compétitivité des entreprises et la protection contre la fraude. En s’attaquant aux trafics illicites, elle joue un rôle essentiel dans la régulation du commerce mondial, en luttant contre les pratiques déloyales, telles que la contrefaçon. De cette manière, la douane contribue non seulement à l’équité du marché, mais aussi à la sécurité générale des consommateurs et citoyens.
Les douanes sont confrontées à de nombreux défis dans leur lutte contre la contrefaçon. L’ampleur du commerce international rend tout d’abord impossible un contrôle systématique de toutes les marchandises. Même en intensifiant les contrôles, les douanes ne pourraient freiner efficacement le flux de produits contrefaits sans risquer de bloquer le commerce mondial. En 2021, en France, le transport routier a atteint 168,1 milliards de tonnes-kilomètres, le ferroviaire 12 milliards et le fluvial 0,5 milliard pour les conteneurs[ix]. Ce volume immense de marchandises traversant les frontières françaises chaque année rend impossible une inspection complète par les douanes.
La fragmentation des circuits d’approvisionnement est une stratégie adoptée par les contrefacteurs. Cette technique, connue sous le nom de « trafic de fourmi », consiste à expédier des marchandises contrefaites en plusieurs envois distincts, souvent par fret express ou postal, pour réduire les risques d’interception[x]. Par exemple, les contrefacteurs peuvent expédier séparément les produits des éléments de marque (logos, étiquettes, etc.), qui seront ensuite assemblés dans des ateliers clandestins en Europe. Cette méthode permet aux trafiquants de diviser les envois de contrefaçons, avec d’un côté les produits et de l’autre les marques contrefaites. En conséquence, les contrôles douaniers standards, conçus pour les flux linéaires, s’avèrent plus compliqués face à une chaîne d’approvisionnement morcelée. Un exemple de cette stratégie est illustré par une opération de la Direction Générale des Douanes et Droits indirects. Dans un communiqué de presse, elle annonce le démantèlement, le 9 décembre 2021, d’un atelier clandestin de fabrication de cigarettes de contrefaçon à Poincy, en Seine-et-Marne. Cette intervention a permis la saisie de machines, de tabac brut et de diverses fournitures dédiées à la production illégale de cigarettes, marquant le premier démantèlement complet en France d’un tel atelier[xi].
La diversité des techniques de dissimulation par les contrefacteurs représente un défi majeur pour les services douaniers. Ces trafiquants recourent à des stratégies telles que le camouflage des produits contrefaits dans des lots de marchandises légales, l’utilisation de document falsifiés ou encore le drop shipping via des plateformes en ligne. Ces procédés rendent les contrôles visuels et documentaires souvent inefficaces et nécessitent des méthodes de détection plus sophistiquées pour contrer ces pratiques.
L’essor des sites de vente en ligne basés sur le modèle du drop shipping a largement favorisé l’augmentation d’articles de contrefaçon. Le vendeur crée une boutique en ligne sur les réseaux sociaux ou sur une plateforme dédiée, tandis que des entreprises spécialisées lui fournissent des services payants pour la mise en place et la gestion de cette boutique, permettant ainsi la vente de contrefaçons en drop shipping. Ce commerce de produits contrefaits sur Internet tend vers une plus grande discrétion, avec l’apparition des « liens cachés » : les articles contrefaits sont dissimulés derrière des annonces de marchandises légales, rendant leur détection plus complexe pour les consommateurs et les services douaniers[xii].
Les services douaniers français font face à plusieurs défis en matière de coopération internationale dans la lutte contre la contrefaçon. La nature transnationale de ce crime globalisé implique des réseaux criminels opérant au-delà des frontières nationales, où la production, le transport, et la vente de produits contrefaits se déroulent souvent dans plusieurs pays. Cette réalité impose un besoin accru de coordination internationale. Cependant, les disparités de moyens, notamment en termes de formation et d’outils techniques dans certains pays, freinent souvent l’efficacité de cette collaboration et limitent les actions concertées contre les réseaux de contrefaçon[xiii].
La contrefaçon, deuxième source de revenus criminels
La contrefaçon constitue la deuxième source de revenus criminels dans le monde[xiv]. En conséquence, la Direction générale des douanes et des droits indirects en fait une priorité dans sa lutte contre les trafics illicites.
En effet, en s’attaquant à la contrefaçon, la douane s’attaque directement à la criminalité transnationale organisée, qui joue un rôle majeur dans la production et la distribution de produits contrefaits. La contrefaçon est souvent associée à des réseaux criminels, car elle constitue une source de revenus relativement peu risquée par rapport à d’autres activités illicites, comme le trafic de stupéfiants[xv]. Des organisations criminelles comme la Camorra, les Triades et les Yakuza ont élargi leur champ d’action en s’impliquant dans ce trafic de biens contrefaits. Déjà impliqués dans des crimes graves tels que le trafic de drogue, la traite des êtres humains et le blanchiment d’argent, ces groupes exploitent la contrefaçon pour renforcer leur pouvoir et leur influence au sein de l’économie souterraine. Les revenus issus de la vente de produits contrefaits peuvent ainsi soutenir d’autres activités criminelles[xvi].
En 2003, le Conseil des Ministres de l’Union européenne soulignait déjà que « la contrefaçon est un vecteur pour le crime organisé et ne peut, en termes de complexité et de gravité, être comparée qu’au trafic de stupéfiants ou d’armes »[xvii]. Dans ce contexte, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) occupe une place centrale dans la lutte contre la contrefaçon, en s’attaquant au démantèlement des organisations criminelles impliquées dans ces trafics. Entre décembre 2020 et septembre 2022, ses investigations menées en partenariat avec Europol et six autres partenaires européens ont abouti à la saisie de 16,7 millions de contrefaçons[xviii].
La réponse douanière
Le rapport de force entre la contrefaçon et les douanes françaises se structure autour d’une dynamique d’innovation constante et d’adaptation, dans laquelle chaque acteur développe des stratégies pour prendre l’avantage. D’un côté, les réseaux de contrefacteurs exploitent les failles des systèmes douaniers et adaptent leurs méthodes pour contourner les contrôles, en s’appuyant sur la diversification des produits, la complexité des chaînes logistiques et l’innovation technologique. De l’autre, les douanes répondent à ces défis en intégrant de nouvelles technologies, en utilisant des outils de détection de pointe et en établissant des partenariats internationaux, afin de contrer ces menaces et d’anticiper les stratégies des trafiquants[xix].
Cette réponse des services douaniers se renforce avec le plan d’action national contre la contrefaçon 2024-2026, qui vise à mobiliser l’ensemble des acteurs et services douaniers autour de cette lutte. Avec plus de 9 millions d’articles de contrefaçon saisis en 2021, plus de 11 millions en 2022 et plus de 20 millions en 2023, ce plan marque une avancée significative, doublant ainsi le volume des saisies. Cependant, ces chiffres révèlent aussi la persistance et l’ampleur de ce trafic[xx].
La douane intensifie également ses efforts de modernisation en adoptant les nouvelles technologies, notamment en utilisant des camions scanners mobiles, équipés de rayons X, capables de radiographier l’intérieur des conteneurs de véhicules. Cette technologie permet de détecter des marchandises potentiellement suspectes. Les images obtenues sont ensuite comparées avec la description du chargement, ce qui aide les douaniers à identifier d’éventuelles anomalies visuelles. Lors d’un doute, les conteneurs sont déplacés vers une zone d’inspection pour un examen approfondi. En mars 2024, dans l’Aude, des poids lourds et véhicules légers suspects ont été contrôlés sur l’aire d’autoroute d’Arzens à l’aide de cette technologie mobile[xxi].
En parallèle de ces avancées technologiques sur le terrain, la douane renforce également son réseau de cybersurveillance pour mieux répondre aux défis du commerce en ligne. La cyberdouane, fondée en 2009 au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), s’appuie sur des spécialistes en cybersurveillance. Depuis la loi du 18 juillet 2023, ces agents disposent d’un pouvoir d’injonction numérique et, en utilisant des identités fictives, peuvent acheter des produits contrefaits pour établir la preuve d’infraction, une méthode connue sous le nom de « coup d’achat »[xxii].
La douane multiplie ses efforts de coopération internationale afin d’améliorer cette lutte. En collaboration étroite avec l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), elle s’engage dans des opérations coordonnées pour identifier et démanteler les réseaux de fraude actifs au sein de l’Union européenne. De plus, les douanes françaises s’inscrivent également dans un partenariat avec leurs homologues européens ainsi qu’avec les titulaires de droits de propriété intellectuelle[xxiii].
Sensibiliser les consommateurs aux dangers des produits contrefaits est également important pour les services douaniers, car cela contribue à diminuer la demande pour ces articles illégaux. Dans cette optique, la douane renforce sa stratégie de communication en développant des outils destinés aux directions régionales et en éduquant le public sur les risques associés aux produits contrefaits. Par exemple, une campagne de sensibilisation, menée en partenariat avec l’Union des fabricants (UNIFAB), vise à informer les citoyens et à mobiliser le secteur privé pour renforcer la vigilance collective face aux contrefaçons.
Campagne de l’UNIFAB, Opération de sensibilisation des consommateurs 2024
La lutte contre la contrefaçon ne se limite plus à intercepter les marchandises illicites aux frontières. Comme l’a souligné Thomas Cazenave, ministre délégué aux Comptes publics, « la sécurité est l’un des plus gros enjeux de la contrefaçon »[xxiv]. Le nouveau plan 2024-2026 privilégie une approche offensive visant à identifier et démanteler les réseaux criminels qui alimentent ces flux. Les douanes françaises ciblent la source même de ces trafics, avec pour objectif d’enrayer leur chaîne logistique et d’affaiblir durablement leurs capacités de production et de distribution.
L.D (SIE28 de l’EGE)
Sources
Soumaré, Ndiaga. (2019). Le droit douanier à l’épreuve de la criminalité transnationale organisée dans l’espace CEDEAO.
Douanes et Droits Indirects. (2024). Plan national anti-contrefaçons 2024-2026.
ONUDC. (2021). Le trafic illicite de biens contrefaits et la criminalité transnationale organisée.
Interpol. (2021). Stratégie mondiale de lutte contre la criminalité organisée et les nouvelles formes de criminalité.
Notes
[i] Vie publique. (2021). Contrefaçons : la France, deuxième pays le plus touché après les États-Unis.
[ii]UNIFAB. (2024). Opération de sensibilisation des consommateurs 2024.
[iii]Le Monde. (2024). Plus de 20 millions de contrefaçons saisies en France en 2023, un « record », selon Bercy.
[iv]République Française. (2024). Plan national anti-contrefaçons.
[v]OCDE. EUIPO. (2021). Le commerce mondial de contrefaçons. Une menace inquiétante.
[vi]OCDE. EUIPO. (2021). Le commerce mondial de contrefaçons. Une menace inquiétante.
[vii]France Info. (2024). Marseille : des dizaines de milliers de pièces automobiles de contrefaçon saisies.
viii]OCDE. EUIPO. (2021). Le commerce mondial de contrefaçons. Une menace inquiétante.
[ix]Statistiques développement durable. (2021). Le transport de marchandises.
[x]Douane & Droits Indirects. (2024). Plan national anti-contrefaçons 2024 – 2026.
[xi] Douanes & Droits Indirects. (2021). Démantèlement d’un atelier clandestin de cigarettes de contrefaçon.
[xii]Douane & Droits Indirects. (2024). Plan national anti-contrefaçons 2024 – 2026.
[xiii]UNODC. (2021). Le trafic illicite de biens contrefaits et la criminalité transnationale organisée.
[xiv]Assemblée nationale. (2016). Question écrite n°981000 : terrorisme.
[xv]UNODC. (2021). Le trafic illicite de biens contrefaits et la criminalité transnationale organisée.
[xvi]UNODC. (2021). Le trafic illicite de biens contrefaits et la criminalité transnationale organisée.
[xvii] Assemblée Nationale. (2005). Rapport d’information sur la lutte de l’Union européenne contre la contrefaçon.
[xviii]Douane & Droits Indirects. (2023). Contrefaçon. Chiffres clés, affaires marquantes 2022 et conseils pour se prémunir.
[xix] Douane & Droits Indirects. (2024). Plan national anti-contrefaçons 2024 – 2026.
[xx] Douane & Droits Indirects. (2024). Plan national anti-contrefaçons 2024 – 2026.
[xxi] L’indépendant. (2024). Aude : quand les douaniers utilisent les rayons X pour déceler drogue, alcool et contrefaçon dans les poids lourds.
[xxii]Vie publique. (2023). Contrefaçons : plus de 20 millions de produits retirés du marché en 2023.
[xxiii]Douane & Droits Indirects. (2023). Contrefaçon. Chiffres clés, affaires marquantes 2022 et conseils pour se prémunir.
[xxiv]AEF info. (2024). « Passer de la saisie au démantèlement des réseaux » : un nouveau plan anti-contrefaçon lancé par Bercy.