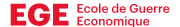Christian Harbulot, directeur et co-fondateur de l'Ecole de Guerre Economique, nous livre une "Etude du cheminement d’une création de concepts" au travers de son parcours dans une série d'articles intitulé "La pensée est une arme"
Premier épisode : L’héritage d’une expérience de combat subversif
La création de concepts n’est pas une démarche exclusivement codifiée à l’intérieur du monde académique. Elle peut être aussi la résultante d’un cheminement intellectuel qui s’appuie sur une série de parcours spécifiques alliant la théorie à la pratique. Pour ce qui me concerne, l’expérience a débuté dans le militantisme des années 70. L’impasse de la violence révolutionnaire m’a conduit à m’interroger sur la question de la stratégie ainsi que sur les modes opératoires d’une culture du combat subversif vécue sur le théâtre d’opération européen. C’est cette première partie de ma vie que j’aborde dans cet épisode 1 intitulé « l’héritage d’une expérience de combat subversif ».
Christian Harbulot
1980-1985 : approche décalée de la stratégie et des arts martiaux
Les tensions politiques des années 60/70 en Europe de l’Ouest ont été le prétexte pour certains groupes subversifs d’extrême gauche de s’interroger sur leur capacité de surmonter des rapports de force physiques.
Dans un premier temps, la réflexion a porté sur le combat « de rue », c’est-à-dire comment préparer les militants à des affrontements avec les forces de l’ordre. En parallèle à cette forme d’apprentissage de la violence « collective », une approche plus individuelle vit le jour à cause des échauffourées avaient lieu régulièrement entre groupes extrémistes de droite et de gauche.
Que ce soit sur le plan collectif ou individuel, les règles d’engagement et le savoir-faire tiré des expériences militantes n’avaient rien à voir avec les approches méthodologiques enseignées à l’armée, dans la police ou dans les services spécialisés de l’Etat.
Les groupes subversifs d’extrême gauche développèrent une culture du combat de rue assez rudimentaire dans la mesure où elle était limitée par des règles d’engagement implicites. Les groupes les mieux organisés tels que le service d’ordre de la Ligue communiste, avaient surtout pour objectif d’encadrer les manifestants. Lors des deux manifestations violentes les plus significatives à laquelle participa la Ligue communiste, les charges à la barre de fer et jets de cocktail molotov et de ras-le-bol étaient très limitées.
En revanche des groupes tels que la Gauche Prolétarienne, commencèrent à pratiquer une forme de violence plus agressive fondée sur des petits groupes qui prirent l’habitude de se spécialiser dans une forme élémentaire de guérilla urbaine et de coups de main sur des objectifs de nature très diverse qui sortaient du cadre spécifique des manifestations de rue.
C’est ce type de dynamique subversive qui déboucha sur une réflexion plus poussée sur l’apprentissage d’un combat à la fois collectif mais aussi individuel.
Des militants se mirent à pratiquer des arts martiaux d’origine asiatique mais aussi la version modernisée de la boxe française. L’émergence diffuse d’une pratique de la lutte armée aboutit aussi à l’embryon d’une culture clandestine du combat. Au milieu des années 70, une mouvance issue du maoïsme commença même à se familiariser avec des techniques de travail dérivées de certaines pratiques du monde du renseignement.
Si cette forme d’engagement initial a débouché sur une impasse politique, il a généré cependant un certain nombre d’interrogations sur le processus d’initiation auxquels ces groupes eurent recours pour affronter l’appareil d’Etat. Mais il était encore trop tôt pour tirer les enseignements opérationnels de cette diversité de pratiques dont les racines historiques les plus solides remontaient au Komintern.
Mais c’est en tout cas à partir de ce terreau de pratiques militantes qu’est née au cours des années 80 une expérience pour le moins originale. Sortie volontairement du cadre politique qui l’avait vu naître, cette expérience fut menée à partir d’un cours de karaté shotokan au sein d’un club de karaté.
Le point de départ de l’expérience est la rencontre entre Bernard Nadoulek, professeur d’arts martiaux qui passa par la suite un doctorat de philosophie et Christian Harbulot diplômé de Sciences Po Paris et ancien dirigeant d’un groupe maoïste impliqué dans un processus de lutte armée. Ils s’étaient croisés dans un collectif d’agitation à Paris à la fin des années 70.
Ils unirent leurs efforts autour d’une double approche : la relecture des principes de la stratégie dans une relation du faible au fort et un apprentissage à vocation syncrétique du combat individuel (mélange d’influence du karaté et du kenjutsu). L’objectif était de bâtir les bases d’un Institut de Stratégie et d’Arts martiaux (ISAM), qui réunissait régulièrement une vingtaine de pratiquants du karaté, intéressés par cette démarche un peu particulière. Cette expérience collective s’échelonna sur une dizaine d’années (1979-1989).
Le point le plus déterminant était de sortir du cadre de réflexion militaire classique concernant les liens entre la stratégie et le combat. Un tel choix était guidé par les limites imposées par les systèmes de référence découlant de la guerre froide et des formes de conditionnement idéologique qui y étaient associés. Le passé subversif de certains nous poussait à transgresser les règles et à aller sur un terrain de recherche sur lequel le monde académique ne s ‘aventurait que très rarement. Nous étions hors normes mais c’est aussi grâce à cette liberté de penser que nous avons pu explorer de nouveaux champs de réflexion.
Ainsi fut amorcée les bases d’une analyse comparée des cultures du combat. Nous commençâmes par prendre en compte les différences de pratiques entre les arts martiaux asiatiques. C’était une autre façon de percevoir la notion de combat.
Un auteur symbolisait cette différence : Miyamoto Musashi (1584-1645). Membre de la caste guerrière japonaise, il fut aussi calligraphe, peintre et philosophe.
L‘étude de son Traité des cinq roues ouvrait la voie à une autre manière de comprendre la dimension individuelle du combat. Et sa pensée mettait en avant l’initiative offensive. Dans un combat, il ne s’agissait pas de défendre mais de vaincre.
Ainsi s’amorce le début d’un fil conducteur méthodologique :
Approche théorique et apprentissage de la pratique.
Recours systématique à l’analyse comparée.
Amorce de réflexion sur la question du combat et ses multiples dimensions.
Cette première phase de réflexion aboutit à la sortie en 1985 d’un numéro unique des Cahiers sur les stratégies et le combat. Les participants à cette expérience venaient de divers horizons. Dans leur jeunesse, Daniel Cohen avant de devenir économiste connu qu’il devint plus tard, avait participé aux réunions du collectif chômage qui était un groupe militant proche du mouvement autonome que tentait d’initier Yann moulier en France. Il en est de même pour Michel Marian, futur philosophe et auteur d’un ouvrage sur le génocide arménien. Il était lui aussi comme Daniel Cohen un ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm. Tous deux écrivirent dans ce numéro de l’Impensé radical.
En parallèle au cours et aux séances de commentaires qui avaient lieu au club Shobudo se tinrent deux séminaires sur des problématiques connexes.
Le premier porta sur la dimension secrète du combat. Une fois par semaine, et sur la base du volontariat, Christian Harbulot assisté de Laurent Nodinot, animèrent en 1987 un séminaire intitulé « Les enjeux stratégiques de la guerre secrète ».
Les séances d’exposés avaient été conçues pour souligner les particularismes culturels des pratiques du monde du renseignement. Nous avons privilégié l’étude des contextes spécifiques qui ont conditionné la mise en œuvre de stratégies de renseignement. La classification anglosaxonne Humint (le renseignement humain), Osint (le renseignement des sources ouvertes, Sigint (le renseignement des signaux), Imint (le renseignement par imagerie) ne traitait pas de cette forme d’approche du domaine. Il nous a semblé utile d’entamer une telle réflexion. La documentation disponible était abondante en matière de récits d’espionnage, de biographies, et de narratifs sur les situations historiques du monde du renseignement. En revanche, il n’existait pas d’ouvrage d’analyse sur les particularismes culturels du renseignement associés aux problématiques d’accroissement de puissance. C’est cette piste que nous avons privilégiée sans délaisser pour autant une seconde piste d’étude sur la créativité subversive associée à l’évolution des structures de renseignement.
Présentation du programme des séances sur la dimension secrète du combat
Le second séminaire se déroula dans un cadre plus académique. Le professeur d’université Jean-Paul Charnay, confia à Christian Harbulot et Bernard Nadoulek, l’animation d’un séminaire pour le compte de son Centre d’études et de stratégie des conflits. Centrées sur les retours d’expérience politico-militaires de groupes subversifs, ces séances amorçaient en filigrane le début d’une analyse des cultures civiles du combat.